-
Par emiliousollies le 30 Juin 2009 à 14:03
Chapitre 7 : Crise de foi à Paris
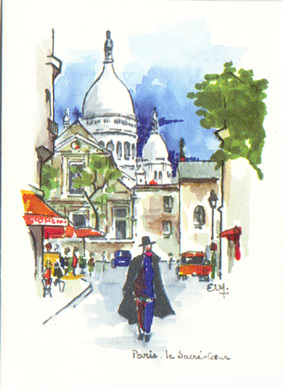
Après sa fuite Gilbert Danan s'était installé provisoirement à Bourg-la-Reine, dans un pavillon de banlieue appartenant à une vieille et gentille veuve qui, pour vivre louait ses chambres à des étudiants. Elle faisait office de grand- mère, veillant sur eux et les accommodant du mieux qu'elle put pour quelques repas ou petits déjeuners. Il s'y trouvait aussi un lointain cousin étudiant en médecine qui lui avait indiqué ce logement, et un autre, vietnamien étudiant en physique, très effacé, plus ou moins réfugié, dont les ressources étaient très irrégulières. Il racontait en détail des horreurs sur le Vietnam et la terreur que faisaient régner les Viets parmi la population. Gilbert s'était établi là, bien que ce fut loin de Paris, car les chambres de bonne intra-muros étaient couteuses et quasi impossibles à trouver. Il avait alerté quelques amis fabricants ou fournisseurs du magasin et ce n'est que quelques mois plus tard que l'épouse d'un directeur de la maison Kodak lui procura une chambre minuscule mais agréable, dans un immeuble bourgeois, près de l'arrêt du métro "Filles du Calvaire", qui lui convint parfaitement.
Il eut du mal à s'adapter au tourbillon de Paris, à la longueur des trajets, à la promiscuité et à l'odeur du métro, à l'indifférence affolée des Parisiens. Il prit une inscription à la Sorbonne où il allait une ou deux fois par semaine en fonction des cours dispensés ou de la notoriété des maîtres de conférences. Comme les photocopieuses n'existaient pas encore, il calligraphiait tous les matins quelques essais ou poésies sur des cahiers qu'il remettait une fois remplis à des maisons d'édition. Les après-midi, il visitait Paris, prenant le métro, s'arrêtant dans tous les endroits ayant une certaine renommée. Il fut très déçu : Saint Germain des Prés n'était qu'un quartier tout à fait banal avec quelques beaux cafés où se pressaient des gens ordinaires ; aucun d'eux n'écrivait fiévreusement un chef d'œuvre sur le zinc. Les existentialistes restaient chez eux et ne défilaient pas dans les rues. A Saint Michel les étudiants étaient quelconques, fauchés et ne ressemblaient pas du tout à Alain Delon ou à Pascale Petit. Il y avait presque autant de Noirs que de Blancs. Ménilmontant, la Butte Montmartre où le commerce avait tout grignoté, n'accueillaient plus qu'une faune anodine ou des touristes. Les Champs Elysées possédaient bien quelques magasins de luxe, mais les princes ou les princesses ne les fréquentaient plus intensément. Bref, on ne voyait rien du tout.

Mais c'était Paris ! La lumière était merveilleuse, les ciels sublimes sur les monuments ou sur la Seine. Il se passait toujours quelque chose, une exposition des Peintres Témoins de leurs Temps, une pièce de théâtre au T.N.P. avec Marguerite Moréno, une soirée de jazz avec Sidney Bechet ou Claude Luther, une fille merveilleuse dans le métro qu'on voudrait aborder pour lui réciter des vers. Un jour il croisa sur les Champs Salvador Dali qu'il interpella respectueusement. Ils bavardèrent quelques minutes et Dali l'autorisa à lui porter des dessins au Meurice; mais il n'y alla jamais estimant peut-être à tort, tromper sa muse. Une fois par semaine, il s'astreignait à porter ses essais aux grandes maisons d'édition, dont il trouvait les adresses dans le Bottin. Quelquefois on le faisait attendre une heure pour lui dire de déposer simplement sa brochure à la standardiste. D'autres fois une secrétaire habituée se faisait rassurante : ce serait présenté au comité de lecture, mais ce serait mieux si c'était dactylographié ! Il remplit ainsi une vingtaine de cahiers et aurait volontiers fait son propre éditeur si les prix de la frappe n'avaient pas été monstrueux pour lui. Les après-midi aussi il lisait pendant une ou deux heures à la terrasse réchauffée des cafés sur les Champs Elysées, à Saint Germain ou à Saint Michel, jusqu'à ce qu'il fut fatigué du bruit et des allées venues. Il recevait régulièrement "Arts", l'hebdomadaire original de Jacques Laurent quelquefois cochon dans ses articles, à qui il adressa son recueil. Ou il allait à la cinémathèque voir les anciens films d'Abel Gance dont le Napoléon dans la version première, ou les nouveautés des cinémas. Gilbert retrouvait rarement un ou deux camarades du lycée professionnel pour un apéritif ou une petite bouffe. Il fréquentait les thés dansants dans le quartier des Champs Elysées, le Mimi Pinson, ceux de l'Avenue Montaigne ou de l'Hôtel Splendid, tous aujourd'hui disparus. Mais il passait le plus gros de son temps à lire comme à son habitude. Il vidait pêle-mêle la production de Dostoïevski, Gide, Montherlant, émaillés de Stephan Zweig, Steinbeck, Faulkner ....
Jamais jusqu'alors il n'avait pu se pencher sérieusement sur lui-même, faire le point sur l'état d'adolescence qu'il quittait et l'âge adulte qu'il abordait. Il profita de ce que le temps ne lui était pas compté pour expertiser son mental. Il avait deux problèmes à résoudre : son avenir professionnel, et celui crucial à ses yeux d'une redéfinition de soi en vue d'aborder la vie en accord avec lui-même. La deuxième étude conditionnait les réponses, car s'il devait choisir une voie artistique il fallait que ce fut en fonction d'une détermination forte, appuyée sur son être profond et qu'il fut capable d'être à la hauteur de ses ambitions. Or il était rempli de doutes : doute sur ses capacités, car les poésies qu'il avait écrites, bien que fortes et ravissantes pour lui n'avaient eu aucun écho à part les compliments polis d'une tante ou d'un camarade littéraire. Personne ne l'avait contacté à ce jour pour discuter sérieusement d'une réalisation concrète. De plus, à part deux ou trois essais romancés à résonance philosophique et humaniste, un peu plus longs que de la poésie, il se sentait encore incapable d'écrire une oeuvre majeure, de construire un vrai roman. Il savait qu'il en avait l'étoffe, il pouvait inventer et disserter pendant des heures sur la sensibilité affective et toutes sortes d'idées, mais farci de lectures à thème, il n'avait pas assez de recul et fonctionnait encore à sens unique s'imprégnant sans pouvoir construire une grande intrigue. N'ayant aucun conseil, aucun guide spirituel, il craignait à juste titre d'être inexpérimenté et de paraître superficiel ou ennuyeux. Or, il préférait demeurer obscur que médiocre.
Son doute était encore plus établi pour les croyances et les dévotions de la religion. Il n'était pas attaché aux cultes et ses parents, bien que fidèles aux traditions hébraïques, ne manifestaient qu'occasionnellement leur foi. La famille ne fréquentait le Temple que rarement à l'occasion de Yom Kippour ou du mariage d'un parent. On l'avait obligé à faire sa Bar Mitsva à un âge tardif car il n'y était pas prédisposé et s'était dérobé. On avait profité de celle de Paul. Pour la première fois de sa vie il avait alors appris et récité un psaume dans une synagogue, pour être proche de son jeune frère en ce moment solennel. Paul, lui avait abordé le rituel avec application (beaucoup pour faire plaisir à Clara qui avait insisté ! ). Cela avait été, aussi, une bonne occasion de faire une grande fête avec les parents et amis. Mais la plus belle confirmation avait été sans contexte celle du premier-né, Henri pendant la guerre. Le Grand Rabbin Abécassis, formidable chanteur devant l'Éternel, avait concocté une cérémonie splendide avec les grandes orgues et des chants solennels. Puis une réception à la maison, pharaonique. Malgré les pénuries Armand avait sillonné l'intérieur du département battant le rappel de ses amis colons ou fermiers. Il avait rapporté en abondance des douzaines de poulets, des oeufs, de l'huile, du sucre du Maroc, de la farine, du beurre, de l'anisette, du vin, toutes denrées rares en ces temps de disette. Pendant une semaine Hermance l'énorme cuisinière spécialiste réputée des banquets de mariage ou de communion, secondée par Clara, avait tranché, cuit, disposé, arrangé les victuailles pour que les invités aient chacun leur assiette de chaque plat, avec des petits pains doux, des gâteaux et tous les mets traditionnels cuisinés à la maison ou dorés au four du boulanger. Ce jour-là il y avait eu foule d'amis et de connaissances dans l'appartement trop petit, et la queue des invités débordait jusque sur le trottoir malgré les deux étages à monter avant d'accéder à la distribution. Pour Gilbert encore jeune, cela avait été une formidable journée de fête avec ses jeux de cartes, distraction préférée des enfants. Il était permis de miser des sous sur les petits paquets. On plaçait les pièces trouées de deux ou cinq centimes en aluminium, ou même les dorées à dix sous, avant de retourner le tas pour savoir qui avait la carte la plus forte. Et aussi la rounda où jusqu'à la dernière minute il pouvait tout perdre.
Puis la communion de Frédéric avait été nettement plus discrète, presque intime comparée à l'opulence de celle de l'aîné des garçons.
Même adolescent Gilbert ne croyait pas en la nécessité des rites et méprisait les simagrées destinées à subjuguer les foules. Sa conviction religieuse n'était pas formaliste. Pour lui la foi devait être intérieure et muette, une sorte de communion directe avec l'Esprit, une liaison supérieure de l'être en prise directe avec le Bon, le Bien, le Beau, une soumission réfléchie et personnelle à une puissance tutélaire sévère et amène. Son adolescence protégée avait été dénuée des épreuves cruelles de l'existence. Les deuils de ses grands-pères avaient eu lieu juste avant ou après sa naissance. Une grande cousine était morte de maladie à quinze ans, mais lui n'en avait alors que dix et on l'avait mis l'écart. La seule fois où il avait eu un contact avec la mort avait été lors de l'accident mortel en vacances d'un jeune scout de son équipe, noyé dans une rivière. Il assista à l'enterrement et vit pour la première fois un cercueil où gisait enfermé un ami ex-vivant qui disparaissait pour toujours de la vie. Il observa et comprit la douleur des parents et des frères, mais il resta comme étranger à la réalité gêné par les démonstrations apitoyées et le défilé du monde. Bien que touché et naïf, il restait surpris et interrogatif en les promesses d'un monde futur meilleur où les bons seraient reconnus et choyés - et les autres torturés - et du devoir de réjouissance tant pour le défunt que pour ses proches, alors qu'il sentait toute l'horreur de la mort.
Gide l'avait déjà ébranlé dans la consistance d'un monde surnaturel. Sa raison d'homme s'affermissant, les cruautés humaines qu'il découvrait au hasard de ses lectures battaient en brèche son confort moral. Si Dieu existait, il ne pouvait tolérer tant d'ignominies.

C'est à Oran que Dostoïevski avait commencé à désillusionner les frémissements de sa raison. Sa rencontre avec les frères Karamazov, leur fréquentation assidue fit voler en mille morceaux la gangue d'innocence qui protégeait son âme simple d'adolescent romantique. Mais, soit qu'il fût trop absorbé dans sa confrontation avec son père, soit qu'il eût trop peur de ce qu'il pressentait, il résista à la nécessité d'éclairer ce point capital de l'existence : la croyance ou le rejet de la foi. Il pressentait que cette interrogation était très grave, très importante pour lui et qu'il ne lui serait pas possible, qu'il ne pouvait pas faire semblant, se contenter d'une réponse floue, réconfortante et diffuse qui suffisait au commun des mortels pour subsister. Il ne pouvait admettre d'approximation sur ce point qui devait impliquer un engagement vital de sa part et il allait exiger de lui-même la certitude de la sincérité de sa foi quel que soit le prix pour aboutir à un verdict.
C'est pourquoi il avait repoussé le moment de procéder à un examen de conscience et s'était déterminé à y réfléchir en ces temps plus paisibles à Paris. Il repoussa l'échéance encore après son arrivée mais une fois son installation achevée, ses occupations ordonnées, il eut tout le loisir de creuser et peser les arguments pour ou contre l'existence de Dieu. Malheureusement, qu'il fût naturellement porté vers la souffrance par une paranoïa subtile, ou que sa raison froide ne supportât pas l'absence tangible et incontournable des manifestations rédemptrices indispensables à une connaissance divine ! il arriva à se convaincre de l'évidence de l'inexistence de Dieu.
Ce fut l'horreur. Il fut bouleversé à l'idée que Dieu n'existait pas. Cette idée le transcenda et tous les piliers de sa raison vacillèrent. Il creusa cette notion et plus il avançait dans cette logique, plus il comprenait la solitude de l'homme, la force du hasard. Seuls ! Ils étaient seuls ! Il n'y avait ni bien ni mal. Il n'y avait pas de juge suprême !

Le beau, le bon, les valeurs morales n'étaient qu'une vaste fumisterie, car il n'y avait rien de supérieur à l'homme, RIEN ! On se retrouvait tous à égalité, c'est-à-dire à zéro. Il n'y avait pas de destin ni de destinée. Il n'y avait qu'une force organique aveugle, en somme le hasard aidé par le déterminisme. Seule la volonté de l'homme, pas celle de Dieu, pouvait détourner le sort. Il en déduisit pas moins que la vie n'avait aucune valeur intrinsèque. Ce concept s'imposa à ses yeux ; l'existence n'était qu'une baudruche gonflée de néant, baignée de néant et lorsque la mort la piquait avec sa faux, cette enveloppe brillante se dissolvait dans le néant comme si elle n'avait jamais existé. Il ne restait rien de l'âme.
Toutes ces pensées dans leur logique absolue le conduisaient au désespoir. Ces sentiments tragiques, enflés par une jeunesse psychosomatique inexpérimentée, l'ébranlaient, le secouaient comme un véritable tremblement de terre intérieur. Toutes les constructions de son intellect, sa morale intérieure s'effondraient comme château de cartes devant cette évidence atroce : ils étaient seuls, seuls au monde, et comme le répétait Dostoïevski, tout était permis, le pire était horriblement possible et faisable !
Dans son subconscient également ces pensées faisaient des ravages : il avait toujours cru d'une manière irréfléchie mais évidente, non consciente, qu'il était prédestiné, que les chances qu'il avait eues dans sa jeune et courte vie, ne relevaient pas du hasard ; il était préservé, car certainement il devait avoir un grand destin. Il DEVAIT être un grand écrivain, un grand artiste, et les quelques accidents dont il avait réchappé s'apparentaient à des miracles, non à de vulgaires coups de bol ! Ces pensées enfantines lui apparaissaient maintenant dérisoires. Il se sentait trompé, cocu, dupé. Son âme qu'il désirait tant élever, qu'il préservait, la rectitude, la perfection qu'il recherchait, qu'il exigeait de lui-même, tout cela était vain, présomptueux ; tout était vanité, vanitas vanitatis !
Un voile se déchirait et sa solitude morale, cette vision monstrueuse, énorme du néant cosmique de l'existence était exagérée encore par sa solitude. Isolé à Paris, loin de sa famille, en pleine crise morale, il évita les quelques amis ou parents auxquels il s'était raccroché à son arrivée. Ils étaient éloignés et avaient leurs études à conduire. Leurs préoccupations étaient différentes des siennes. Une fois ou deux, il était sorti avec eux. Il les avait accompagnés juché à l'arrière de leur scooter, dans les soirées dansantes estudiantines données par les Écoles de Médecine, Dentaire ou les Beaux-Arts. Ses copains, fauchés comme bien d'autres, inventaient mille artifices pour ne pas acquitter le droit d'entrée et il faisait comme eux.
Une nuit il s'était affublé d'un vague brassard et avait réglé consciencieusement la circulation des voitures et du parking pendant deux heures, avant de pouvoir s'infiltrer dans les locaux du bal.. Il y avait plusieurs orchestres dans des salles différentes, où les jeunes dansaient, buvaient, bavardaient, draguaient jusqu'à l'aube, s'adonnant au be-bop ou écoutant du New Orléans.
Lui n'était pas totalement dans le coup ; il n'était pas un véritable étudiant. Ses préoccupations étaient tout autres que la réussite d'un examen. Il n'avait pas leur franche jeunesse roublarde, décontractée, remplie tour à tour d'études et d'aventures sans lendemain. C'était un jeune homme renfermé, distant, (« préservatifisé » disait-il) et les autres savaient bien qu'il aurait voulu entrer dans leur communauté, et lui croyait qu'on le ressentait mal, presque comme un trouble-fête.
Un jour qu'il dialoguait avec un étudiant en médecine, ils s'étaient heurtés sur la question technique de savoir comment et à quel moment l'esprit naissait : la spiritualité commençait-elle avec le nourrisson ou peut-être avec le fœtus. Fallait-il confondre les réflexes physiologiques avec les premiers signes d'intelligence ? A quel moment n'est-on plus un organe ? La discussion avait dégénéré sur l'avortement qui n'était pas la préoccupation de Gilbert.
Une autre fois, à l'entrée de la Sorbonne, il avait sympathisé au premier abord avec un étudiant allemand. Quand ils en étaient arrivés à parler de leurs auteurs favoris, l'autre avait cité Kant, Kierkegaard, Hegel, lui : Voltaire, Bergson, Dostoïevski, Gide, Montherlant. L'Allemand avait été dédaigneux et condescendant devant sa pauvreté intellectuelle. En réalité, Gilbert qui avait tenté de percer le monde des philosophes professionnels, mésestimait ces penseurs trop spécialistes, les jugeant abscons et inintéressants dans la quête existentielle ; son inclination, sa culture peut-être superficielle, le poussaient davantage vers la découverte des maîtres humanistes, du roman philosophique. La pureté du style l'enchantait autant que la rhétorique ou la logique. "L'Éducation sentimentale" lui paraissait plus instructive sur l'âme humaine que les dialectiques kantiennes ou hégéliennes qu'il trouvait hermétiques, ardues, déconnectées de la réalité pratique, presque inutilisables pour une intelligence moyenne en quête de raisons de vivre.
Il sortit moins restant cloîtré plusieurs jours à débattre en lui-même des conséquences successives de la réalité qu'il appréhendait. Il s'enferma ainsi dans de lugubres pensées. A Paris, séparé, sans attache, il ne pouvait être ni secouru, ni secoué. Ses horaires devinrent anarchiques, ses repas décalés ou oubliés. Obnubilé, il cheminait lentement dans son mental car il replaçait, il recadrait tout son psychisme en accord avec cette découverte : pas de Dieu, pas de divinité, pas de religion, pas de morale. Rien qui, d'une manière absolue, puisse protéger l'homme. Il dérivait et se trouvait désemparé, abandonné, aigri. Sa solitude mentale s'enflait, devenant aberrante. La mort qu'il n'avait pas encore pleinement assimilée prit pour lui toute son importance dans le phénomène inconséquent de la vie. C'était la vie qui était une anomalie, un accident, et pas la mort. La mort, le néant devenaient l'état naturel éternel : la vie n'avait plus tellement d'importance. Elle n'avait pas VRAIMENT d'importance. C'était un éclair, un éclair de conscience, de lucidité. A peine se rendait-on compte de la catastrophe de son existence, de la condition humaine, qu'on était déjà éteint, emporté pour toujours.
Des idées de suicide, le cheminement d'une certaine logique du suicide que dégageaient les personnages des Frères Karamazov ou le nihilisme de Gide, Nietzsche, lui revenaient à l'esprit. Alors qu'à la première lecture ces concepts qu'il comprenait et estimait, lui paraissaient étrangers, non conformes à sa personnalité enflammée, maintenant ils s'harmonisaient avec son état. Il finit par être pleinement en accord avec eux. La conséquence mathématique de son raisonnement conduisait au suicide. Il retournait dans son esprit l'analyse de la vérité réelle, et de plus vexé d'une certaine manière de n'être pas remarqué ni des Dieux ni même des hommes, il inclinait presque autant par dépit que par conviction vers une suite logique et rationnelle extrême. Il oublia de se raser, chose qu'il détestait auparavant. C'était donc mauvais présage! Il se mit aussi à traverser au feu vert sans souci de la circulation. Il s'approcha de plus en plus des rames de métros qui sortaient en trombe des tunnels jusqu'au jour où en déséquilibre, un surveillant se précipita sur lui, le rejeta en arrière et l'enguirlanda de tous les noms.
- "Vous êtes fou ! Donnez-moi votre identité, je vais appeler la police, etc..."
En réalité dans son tréfonds, il restait encore hésitant, car une dernière petite force irréfléchie combattait son pessimisme. Quelque chose le retenait ; c'était certainement aussi sa jeunesse, l'énergie organique, physique, sauvage, qu'il tenait en lui. Ne se destinait-il pas à faire de grandes choses ? Toute la poésie, tous ses sentiments si beaux, si forts qu'il ressentait et qui devaient gouverner sa vie devaient-ils être vains, n'existaient-ils pas en lui ?
Il y avait la passion et il y avait la raison. D'un côté, il ne voulait pas se soumettre à la loi commune qu'il trouvait terne, médiocre, une vie sans hauteur, sans Dieu pour juger des justes ; de l'autre, il ne pouvait comprendre et admettre que le bien soit aussi peu valeureux que le mal. Il était comme Faust prêt à se prostituer pour un faux-semblant.
Il commença à saisir pourquoi il reculait toujours au moment de procéder à l'irrémédiable sur le Pont des Arts: Pourquoi s'enticher d'un Dieu? Il y avait toujours l'humanité souffrante. Pourquoi retirer à l'homme ce qui était en somme sa force, la vie, pour la seule raison qu'il était seul ? Et alors ? Seul pour seul, il restait encore du travail à faire ! On pouvait - sans espoir - bâtir, peut-être comme de viles fourmis mais mieux, car on avait la CONSCIENCE !
Il se rabattit sur cette idée forte de conscience. Mais oui, avec la conscience, grâce à la Conscience, on pouvait remplacer le divin inné par une donnée relative. Qu'est-ce qui définissait le divin sinon la conscience ? « Je suis celui qui suis ». Présente chez l'homme, construite dans le bien, élaborée pour l'amélioration de la Race Humaine, ne serait-elle pas le miracle ? Non, pas un miracle ! Une réussite extraordinaire du hasard ! Il pourrait s'acharner à la parfaire ; ce ne serait pas vraiment de la même qualité que ce qu'il avait perdu, cependant cela le sauvait ; c'était un but noble et fier de vivre conscient sans espoir. Et bien, s'il n'y avait rien, il produirait quand même quelque chose ! On pourrait montrer de quoi l'on était capable, même sans le grand spectateur !
La résignation succéda au désespoir. Une certaine ligne de conduite, un raisonnement se rétablissaient dans son esprit chaviré. Il était presque mort, " il avait mouru " et il émergeait, il revenait tel Dante vers les vivants. Mais il ne put jamais être comme avant. Il avait perdu, abandonné quelque chose dans son voyage : ses illusions vitales, la foi passionnée. Il revenait, squelette décortiqué, marqué psychiquement d'une manière indélébile par la mort. Cela se voyait dans les portraits presque morbides qu'il crayonnait de lui-même et dans les écrits de son journal qu'il enflait de ses élucubrations déçues, de son orgueil bafoué. Il décida de délivrer son message, le résultat de ses batailles. Son expérience si terrible devait être récupérée et apportée au monde pour servir. Car c'était là sa dernière déduction : l'homme devait SE servir .Se servir d'une part de la nature, d'autre part, utiliser son intelligence pour améliorer son sort, s'élever, se hausser maladroitement et SANS ESPOIR au niveau des dieux par le travail et la science. Prométhée avait échoué, on recommencerait ! Et c'est ainsi qu'il rejoignit tristement les pelotons immémoriaux des résignés.

En écoutant en boucle la 6° symphonie de Tchaïkovski qu'il trouvait aussi pleine des sentiments et des affres de la vie que de ceux de la mort, Gilbert écrivit une pièce de théâtre désespérée qui finissait bien : une mère maquerelle ( la raison) raisonnait un jeune godelureau qui voulait attenter à ses jours par désespoir affectif et défaut d'idéal. Elle finissait par le sauver de la tourmente à force d'amour, de conseils primitifs, de gifles, qu'elle opposait pied à pied au mal de vivre charnel du jeune homme. Il se laissait convaincre des agréments de l'existence : Travail, Famille, Patrie et finissait par sauver sa vie et se marier avec une jeune prostituée, en laissant pour compte la vieille dame dépitée par un si brusque revirement, et reprendre son commerce.
Après avoir bien bavé sur ce pensum, il le mit au propre et dépensa une petite fortune pour le faire taper à la machine et ronéotyper en quelques dizaines d'exemplaires qu'il déposa dans plusieurs théâtres et à nouveau chez quelques éditeurs. Il contacta le mari d'une belle-sœur d'une de ses tantes qui avait des intérêts dans une salle. Il lui présenta son oeuvre dans un hall d'hôtel. Il lut sa pièce avec des sanglots dans la voix, avec des accents de sincérité tels que le promoteur dut employer beaucoup de précautions pour lui dire que c'était injouable en la forme, mais que, s'il pouvait supprimer le côté un peu trop philosophique pour en faire un sombre drame passionnel, ils pourraient se revoir et en rediscuter.
Ce furent les dernières velléités de la vocation intellectuelle du jeune homme. Parti plein d'espérance et d'ambition il revenait de son épisode parisien rempli de l'amertume de n'avoir réalisé aucune de ses aspirations, de n'avoir trouvé ni maître à penser ni réponse à sa quête existentielle. Quelque temps après, il résolut douloureusement de reprendre le chemin du bercail d'où lui parvenaient des courriers comminatoires ou suppliants. Avant de retrouver le giron familial si commun, Gilbert décida d'enterrer ses illusions perdues et de savourer ses dernières économies. Il désirait connaître la Côte d'Azur et se détacher de ce Paris si dur où plus rien ne le retenait.
ARTICLE DE JOURNAL
- A Nice, au cours du Salon du livre, j'ai rencontré un de ces professeurs de lettres pasIsionnés dont on aimerait avoir été l'élève. Nous avons sympathisé. Très vite il m'a parlé de son drame, de son mal, devrais-je dire. II écrit. Et écrire peut avoir tous les symptômes d'une maladie grave, inguérissable. Après avoir communiqué son amour de la littérature à des générations d'élèves, après avoir vécu avec ce feu qui le brûlait, il s'est délivré enfin du livre de sa vie qu'il a intitulé Dur désir. Un bon titre. Mais c'est alors que son calvaire a commencé. Un livre, un roman, n'existe vraiment que lorsqu'un éditeur a accepté de le publier. C'est une quête souvent désespérante. On ne sait si on doit attribuer le refus de son livre à son absence de qualités ou à son manque de recommandations. On sent monter en soi les affreux symptômes de la jalousie : tant de romans parfois médiocres sont publiés, ont du succès et obtiennent même des prix littéraires. Pourquoi pas le mien? Pourquoi me refuse-t-on cette chance qu'on offre à des gens qui n'ont ni mon mérite, ni mon talent, ni ma passion pour la littérature? Ce drame, beaucoup d'écrivains qui tentent de se faire publier le vivent. Les critères qui conditionnent la publication d'un livre sont aussi mystérieux que ceux qui président au succès, au bonheur, à l'amour. Que dire à ce professeur qui m'écrit et me confie son désarroi avec l'accent déchirant d'un amant désespéré? Lui aussi veut exister d'une vraie vie. Mais elle se refuse à lui.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique









